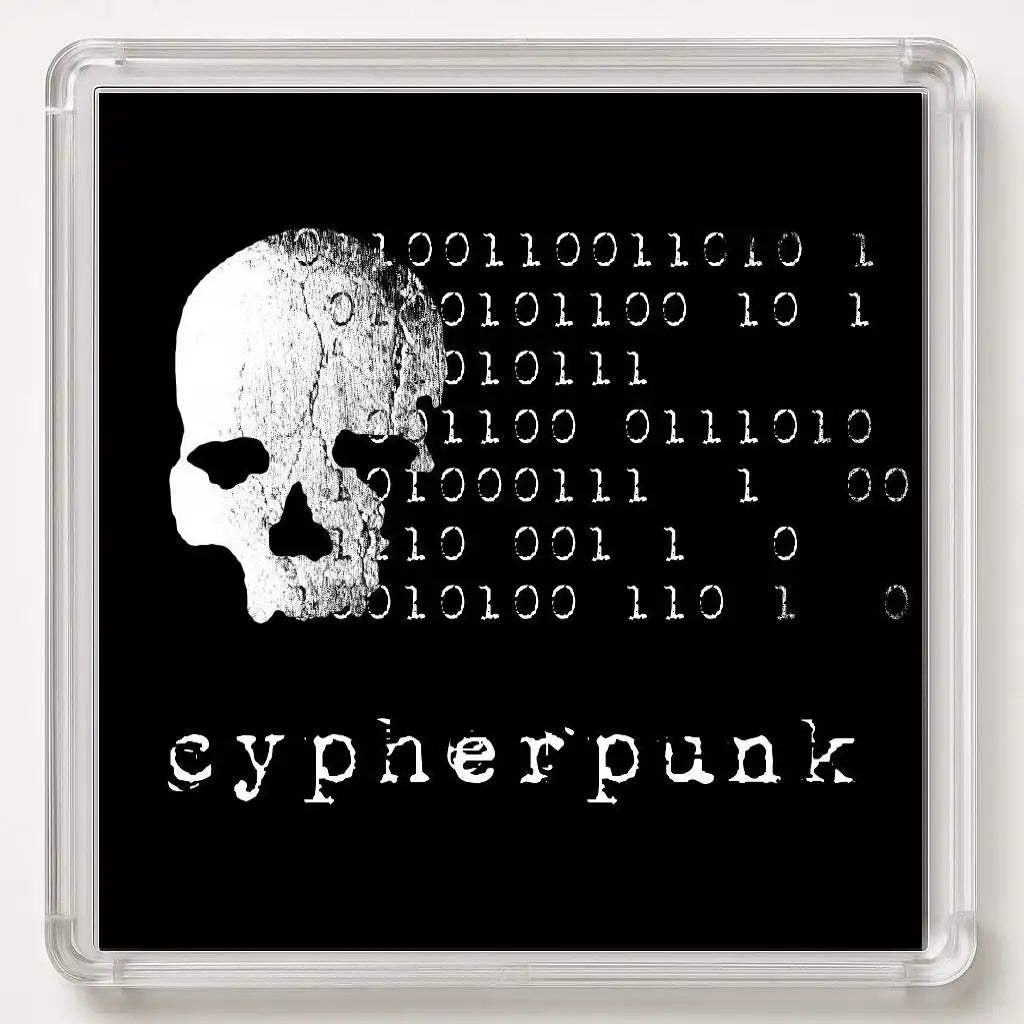
THE CODE OF RESISTANCE
Share
Avant Bitcoin, il y avait des visions. Avant le code, il y avait des manifestes. Avant la blockchain, il y avait la résistance. Voici la généalogie cachée de Bitcoin. Ce n’est pas une histoire financière, c’est une épopée cryptographique. Tout commence au début des années 1980 avec un homme nommé David Chaum. Souvent oublié mais impossible à effacer, il fut le premier à comprendre ce qui arrivait. En 1981, il publie Untraceable Electronic Mail, Return Addresses, and Digital Pseudonyms, un article qui jette les bases de la communication anonyme et de l’identité en ligne. En 1989, il lance DigiCash, une tentative ambitieuse de créer de l’argent numérique basé sur des signatures aveugles cryptographiques. Le projet échoue commercialement mais réussit philosophiquement. Chaum n’a pas seulement inventé l’argent numérique, il a inventé l’idée même que notre vie privée pouvait être protégée mathématiquement, que la liberté pouvait être codée. Son travail précoce allait inspirer toute une génération de rebelles. En 1988, Timothy C. May publie The Crypto Anarchist Manifesto, un texte aussi radical que visionnaire, qui aujourd’hui encore sonne comme une prophétie. Il y prédit un futur où les individus communiquent et échangent librement, sans l’intervention des États, grâce au chiffrement comme bouclier et aux mathématiques comme arme. May comprend que la révolution numérique à venir ne sera pas qu’une question de confort, mais de souveraineté. En 1993, Eric Hughes écrit A Cypherpunk’s Manifesto et donne ainsi un nom au mouvement. La vie privée est nécessaire dans une société ouverte à l’ère électronique, déclare-t-il. Hughes croit que la liberté ne peut être confiée aux gouvernements ni aux multinationales. Elle doit être conçue, développée, partagée, et elle doit être open source. Cette même année naît la mailing list des cypherpunks. Ce n’est pas un forum de discussion, c’est un champ de bataille d’idées, où la philosophie croise le code. Et parmi ses contributeurs les plus actifs, on trouve Hal Finney. Brillant cryptographe, Finney travaille sur PGP 2.0 puis crée en 2004 Reusable Proofs of Work, un précurseur direct du système de minage de Bitcoin. En 2009, il devient la première personne au monde à recevoir une transaction Bitcoin. Il n’est pas seulement un pionnier, il est le pont entre l’idéologie et la réalisation. Un autre esprit marquant est Nick Szabo, informaticien et théoricien du droit fasciné par la nature de la monnaie. À la fin des années 1990, il introduit les smart contracts, puis en 1998 propose Bit Gold, une monnaie numérique décentralisée fondée sur la preuve de travail. Ses écrits, comme Shelling Out, constituent la base philosophique de l’or numérique. Puis arrive Wei Dai, qui en 1998 présente le concept de b-money, un système d’argent numérique anonyme et distribué, cité explicitement dans le whitepaper de Bitcoin par Satoshi Nakamoto. B-money intègre déjà les éléments clés de Bitcoin, registres publics, preuve de travail, clés privées, consensus sans autorité centrale. Pourtant, tout cela reste encore théorique jusqu’à l’apparition d’un nom sans visage. Satoshi Nakamoto. En 2008, il publie le whitepaper de Bitcoin. Ce n’est pas le début. C’est la synthèse. La convergence de décennies d’efforts cypherpunks, de frustration, de révolte silencieuse. Mais même après le lancement de Bitcoin en 2009, le réseau a besoin de figures de référence. L’un des premiers est Adam Back, créateur de Hashcash, un système de preuve de travail inventé en 1997 pour lutter contre le spam. Il devient le moteur du minage Bitcoin. Adam Back est cité dans le whitepaper et reste l’un des rares liens directs entre Satoshi et le monde réel. Puis vient Zooko Wilcox, autre cypherpunk, co-auteur du Zooko Triangle, une théorie sur les systèmes de nommage, et fondateur de Zcash, une cryptomonnaie centrée sur la vie privée basée sur les preuves à divulgation nulle de connaissance. Son travail prolonge le combat pour l’anonymat à l’ère de la surveillance généralisée. Mais les cypherpunks ne sont pas que des codeurs. Certains sont des lanceurs d’alerte. Julian Assange, présent sur la mailing list dès les années 1990, utilise le chiffrement pour lancer WikiLeaks, une plateforme mondiale de transparence radicale. En 2010, alors que Visa et Mastercard bloquent les dons, Bitcoin devient leur bouée de sauvetage. Ce n’est pas qu’un moyen de paiement, c’est une déclaration d’indépendance. Et enfin, l’une des voix les plus puissantes de l’ère post-Satoshi n’est pas un développeur mais un ancien employé de la NSA. En 2013, Edward Snowden révèle l’ampleur du système de surveillance global. Il utilise des communications chiffrées, des routes anonymes, des outils open source, tous inspirés ou créés par les cypherpunks. Snowden montre au monde pourquoi leur mission est vitale. Pourquoi la vie privée ne concerne pas seulement ce qu’on cache, mais ce qu’on protège. Le droit à l’autodétermination. Le droit de contester. Chacune de ces figures porte une torche. Certains ont éclairé le chemin. D’autres ont écrit les règles. D’autres encore ont construit les outils. Certains ont payé le prix. Ensemble, ils forment l’ADN de Bitcoin. Ce n’est pas un produit de startup ni de capital-risque. C’est le résultat d’une guerre silencieuse pour la liberté, menée pendant des décennies, non avec des armes, mais avec du code. Bitcoin n’est pas seulement une révolution financière. C’est une révolution culturelle. Technologique. Poétique. Bitcoin est l’héritage vivant des Cypherpunks. Le fruit de leur insoumission. La poursuite de leur mission. Bienvenue chez 100 Blocks.
👉 À lire aussi :
